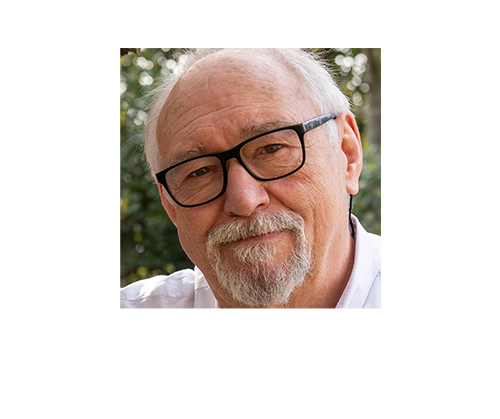Démocratie et gouvernance
La conduite des projets territoriaux, pour être appropriée, doit engager de large concertation et entraîner une dynamique d’engagement collectif. On parle beaucoup de démocratie participative et de gouvernance sans que ces termes soient appuyés sur une véritable connaissance des phénomènes humains en jeu mais plutôt sur de bons sentiments nourris d’idéologies régressives. Les ambitions peuvent être grandes en la matière à condition d’en tenir les exigences.
Il est un temps de mutation où émergent de nouveaux concepts
tel que celui de gouvernance. On a rapidement l’intuition que cela touche
à du connu mais qu’il y a néanmoins quelque chose d’autre qui en
fait l’intérêt. Gouvernance s’applique au domaine des grandes
organisations et aussi celui des territoires ou espaces du politique qui nous
intéressent en priorité ici. Il y est question de la
manière de gouverner, de la bonne pratique pour conduire les affaires
collectives impliquant une certaine participation responsable des acteurs ou
populations concernées.
Le lien avec la démocratie est
souvent fait, évoquant le voeu d’une démocratie participative,
alternative à une démocratie représentative jugée
insuffisante… notamment par défaut de "bonne gouvernance" de
la part des dits représentants. La gouvernance est ainsi quelque fois
une alternative critique dont "la bonne pratique" reste
néanmoins incertaine, notamment chez ses promoteurs qui se nourrissent
surtout de la dénonciation des pratiques existantes. Or cette
émergence mérite mieux.
Elle évoque la question de
la conduite d’une population sur un territoire. Cette conduite est d’un autre
ordre que la seule "gestion des choses" qui prévaut trop
souvent. La gouverne ou le "gouvernement des hommes" reviendrait-il
à l’ordre du jour ?
Sur un territoire le gouvernement des hommes
suppose trois conditions :
– Il faut qu’il y ait identification collective
de la population, identité qui est la condition d’une quelconque
projection dans l’avenir. Sans identité collective pas de projet
commun.
– Il faut qu’il y ait justement un sens, une ambition, une
orientation donnée au futur et dans lequel la population se
reconnaît et, mieux, y retrouve ses aspirations, valeurs et motivations.
Sans orientation commune engageante pas de projet partagé.
– Il faut
enfin que l’idée d’une marche en avant collective soit acquise, restant
à en structurer dynamiques et modalités, reliant des acteurs et
moyens mobilisés sans quoi le projet n’est pas approprié par les
acteurs et la population. C’est là que les projets territoriaux trouvent
leur place.
Qu’y a-t-il de nouveau ?
– Les territoires
s’identifient de plus en plus à des "communautés de
Sens", c’est-à-dire des communautés de devenir et de projets
ancrés dans une vocation collective.
– La vocation collective du
territoire "autorise" une volonté partagée, une
orientation commune, une direction de l’avenir posée et proposée
en relation avec d’autres territoires.
– Les projets territoriaux sont
alors l’expression d’une volonté collective se structurant, une mise en
mouvement et sont la réalisation de projets concourants à un
développement "approprié".
C’est là le
Sens du temps qui remet en question les logiques purement gestionnaires et
rationalisantes centrées sur les choses, ignorant les hommes et les
enjeux "humains" de leur devenir. C’est là aussi le Sens d’un
temps où la maîtrise par les hommes de leurs communautés
territoriales se fait plus responsable et plus autonome, à contre
courant d’une critique systématique du progrès et des valeurs de
la "civilisation" humaine.
Les enjeux sont très
vastes, rejoignant les questions les plus essentielles de la vie collective
à celles plus pragmatiques de la conduite des affaires communes. La
démocratie et ses conceptions sont interpellées mais aussi la
compréhension des sociétés humaines et de leur
"marche en avant" et enfin celle des pratiques de gouvernement des
hommes dont la "gouvernance" est la conception nouvelle".
Il est clair que cela concerne les responsables politiques, les dirigeants
territoriaux, les services de l’Etat qui y trouveront de nouvelles politiques
de service et aussi tout ceux qui ont à en tirer des enseignements pour
leur propre participation aux affaires communes et la conduite des
responsabilités qu’il ont à assumer dans leur secteur.
Il
nous faudra donner quelques éclairages au préalable sur deux
questions essentielles :
– La nature des communautés humaines, le
Sens du bien commun et les étapes de leur évolution qui
justifient le principe même d’une bonne gouvernance.
– La nature de
la démocratie et ses modes d’exercices en fonction des stades de
maturation de la communauté et des diverses populations.
Les
communautés humaines sont le terrain même de la gouvernance. Il
s’agit donc de les comprendre comme des communautés de devenir,
partageant une communauté de Sens qui deviennent ainsi
communautés de projets. Sans projet, sans direction à prendre et
des objectifs ou des enjeux à atteindre dans cette direction, il n’y a
rien à gouverner.
C’est donc le nouveau visage des
collectivités territoriales concernées: des communautés de
Sens partageant une ambition pour l’avenir. Cette conception fait suite
à d’autres qui correspondent en fait à des sociétés
moins évoluées.
Les sociétés
archaïques sont sous le régime des affects, des impulsions, de
pouvoirs d’emprise. S’il s’agissait d’y exercer quelque "gouvernance",
c’est à la pacification et au contrôle des pulsions excessives
qu’il faudrait s’attacher par le biais d’un pouvoir directif et donc
régulateur.
Les sociétés encore primaires se
préoccupent surtout de leur subsistance et de leur confort. La bonne
gouvernance ne porterait alors que sur la gestion des choses au travers d’une
organisation optimisée. C’est une approche technicienne qui
prévaut.
Les sociétés secondaires sont
engagées dans des jeux d’identité et de représentations
collectives réglées par le droit. La gouvernance s’exerce par une
démocratie représentative qui établit la loi et les
règles communes.
Les sociétés de types
tertiaires, émergeantes, font appel à un autre critère
qui est le Sens de l’avenir qui forme la communauté et réclame
une conduite dans ce Sens de la marche en avant de la collectivité. On
notera ici que l’essentiel pour l’avenir de la société devient le
Sens de l’avenir et le projet qui donne vocation au territoire dans un contexte
d’élargissement européen et de mondialisation.
Il
apparaît à l’évidence que les trois étapes
antérieures sont perpétuellement remises en question. Il
apparaît aussi que de puissantes forces régressives tendent
à y retourner ou s’y fixer et que certaines pratiques politiques
sociales, institutionnelles, professionnelles même contribuent activement
à ces régressions.
Cependant la nouveauté c’est
aussi que c’est la marche en avant, l’entrée résolue dans une
société de type tertiaire qui contribuera dorénavant le
mieux à maîtriser les stades antérieurs de
développement. Faut-il pour résoudre le problème des
banlieux revenir à la tribu ou au nationalisme comme régime
politique. Faut-il pour résoudre les problèmes de l’emploi
abandonner toute mondialisation économique, sociale, industrielle et
culturelle ? Faut-il pour résoudre les défaillances de la
démocratie en rajouter en incantations, formules, procédures,
lois et règlements ? Non il faut engager la cité, le territoire
dans une dynamique de projet dont le Sens se traduit par des valeurs, un
potentiel, une vocation et au bout du compte une ambition humaine
partagée. Notons que cette échelle de maturité des
sociétés humaines est aussi celle des hommes et des institutions.
Elle est celle des conceptions et des pratiques de la politique et de son
rôle.
Nous vivons une mutation entre la société des
représentations et la société du Sens comme il en existe
à d’autres seuils d’évolution. Chaque mutation fait crise, plus
ou moins exacerbée, où l’attrait du dépassement se trouve
combattu par la crainte de la remise en question, quitte à fuir dans la
régression. Ces réactions humaines compliquent l’analyse ce qui
permet de dire n’importe quoi sur ce qui se passe. C’est du côté
de l’espérance et de l’enthousiasme que se trouve la vérité
du devenir. L’angélisme serait de croire que les problèmes
n’existent plus, le pessimisme qu’ils sont fatals et l’optimisme qu’il y a de
nouvelles façons de les poser et de les résoudre pour aller plus
loin.
Il faut donc bien intégrer que la gouvernance est
justement ce type de pratique qui convient à une société
de type tertiaire. Elle convient à l’élaboration et la conduite
des projets territoriaux qui redéterminent un lien social, un pacte de
Sens donc de valeurs, de significations, de direction et de
méthodes.
Cependant elle ne peut ignorer :
–
l’hétérogénéïté des situations et des
niveaux de maturation des hommes et des institutions (sans s’y enfermer
évidemment),
– que son premier enjeu, c’est de définir et
conduire un processus de maturation vers une plus grande maîtrise
collective d’un devenir, maîtrise collective qui est la figure nouvelle
du bien commun.
La gouvernance une pratique
démocratique de la conduite des projets territoriaux
Tout d’abord il faut situer trois conceptions classiques des projets
territoriaux qui se limitent aux âges d’évolution
antérieurs.
– Le projet territorial est par exemple pour
certains une opportunité à saisir dans les jeux de
puissance et d’intérêt. La "gouvernance" n’y a que peu
d’intérêt à moins de servir de "mot de passe
utile".
– Le projet territorial est seulement, pour d’autres,
un projet d’équipement, c’est l’occasion d’obtenir des
crédits permettant de réaliser ou d’améliorer l’existant
quant à l’organisation de la vie matérielle collective. La
gouvernance utile ne dépasse guère l’inventaire des besoins que
des services techniques peuvent réaliser.
– Le projet
territorial est un peu plus loin un projet d’aménagement du
territoire. Il s’agit de rationaliser le territoire en optimisant les
différentes fonctions selon les modèles les idées et les
règles du moment et de fixer les cadres d’action des années
à venir. C’est la pratique classique, souvent promue par l’Etat et les
services spécialisés, à laquelle les collectivités
territoriales sont appelées à souscrire contractuellement pour
bénéficier des avantages qui en découlent. La gouvernance
reste cantonnée alors au débat accessoire ou idéologique.
La démocratie formelle est sensée régler les
procédures de décisions. C’est bien parce que les hommes et les
sociétés commencent à aspirer à un autre temps de
responsabilité que ces pratiques apparaissent comme notoirement
insuffisantes. Ils commencent à entrevoir qu’il y a des choix de Sens
et de devenir en jeu alors que pays et collectivités forment de
nouvelles "communautés territoriales" confrontées
à un monde en mutation et à une mondialisation riche de menaces
et d’opportunités,
Quels sont donc les termes d’un processus de
gouvernance pour une société qui entre dans un stade de plus
grande maturité?
Trois étapes sont indispensables :
– Celle de l’identification de la communauté sans laquelle il n’y
a pas de projection dans l’avenir possible,
– Celle de l’orientation
de son devenir sans laquelle il n’y a pas de volonté commune possible
donc de projet commun,
– Celui de la mise en mouvement sans
laquelle le projet reste une abstraction technocratique qui ne concerne pas
vraiment la population et les acteurs locaux.
Il nous faut les examiner
maintenant :
La phase d’identification
Un territoire est
avant tout le lieu d’existence d’une communauté de Sens. Ce qui fait
communauté, c’est le Sens de l’existence commune et du bien commun
partagé. Or la première condition pour se projeter dans l’avenir
est de s’identifier en tant que communauté de Sens. Pour cela c’est
à un patrimoine de valeurs communes, c’est à une culture et aux
potentiels humains qui sont cultivés que l’on peut recourir.
L’identification ne doit pas se faire à un "état des
lieux" ou à une définition juridico-administrative
subalterne mais à un patrimoine de valeurs. Ce patrimoine de valeur est
le potentiel culturel "à cultiver" pour progresser dans
l’avenir. Il intègre les ressources matérielles dont la valeur
dépend seulement de ce qui peut en être fait (contrairement
à des visions patrimoniales abstraites qui déshumanisent le
patrimoine et donc les pratiques qui s’y rapportent). Il intègre aussi
les qualités et qualifications humaines collectives, compétences
et talents communs, art de vivre et d’agir ensemble et tous autres
caractères liés à l’histoire singulière (ancienne
ou récente) de la communauté.
Cette identification sera
donc le fruit d’études, d’analyses et notamment d’analyses de
cohérences culturelles débouchant sur des représentations
des valeurs propres dans lesquelles la communauté peut se
reconnaître et par une communication appropriée. La gouvernance
passe par un stade de "représentation" où la
"représentativité" est l’idée force. Il y faut
aussi une représentativité légitime de l’instance qui
prend l’initiative. C’est le rôle des élus, privilégiant le
meilleur, le potentiel, le patrimoine sur ce qui n’est pas porteur de
promesses.
C’est alors aux principes de la démocratie
représentative que l’on peut se référer attendant que les
représentants représentent "le meilleur" de la
communauté par eux mêmes et surtout par les
"représentations" qu’ils donnent à elle-même de
la communauté. On voit bien l’importance de la communication et les
déviances qu’une "mauvaise gouvernance" induirait en flattant
notamment tous les ressorts du narcissisme collectif ou des manipulations
identitaires. Il est donc indispensable que cela repose sur une analyse en
profondeur des richesses patrimoniales d’origine culturelle de la
communauté.
L’orientation
la mise en lumière
du patrimoine de valeurs culturel propre fait déjà émerger
le Sens du bien commun. Il s’agit maintenant de l’éclairer, le
repérer et le traduire en termes de vocation, d’ambition et de projet,
de le projeter dans le futur.
Pour cela un travail est à faire
qui relie le patrimoine aux horizons du futur. Il faut à la fois :
– un travail de discernement du Sens du bien commun,
– la formulation d’une
vocation générique,
– un travail de prospective
opérationnelle qui croise le patrimoine de richesses potentielles et les
horizons du futur dans le contexte de la mutation,
– un travail de
créativité générative pour dessiner
l’ébauche d’un projet inspiré (par le Sens et les horizons
éclairés),
– la constitution d’une force de conviction et de
détermination, celle d’un homme et d’une équipe au minimum, en
mesure de se poser en force de proposition face à la communauté
territoriale.
Ce travail de détermination débouche sur
une offre d’orientation susceptible de devenir une ambition commune. La
validation de cette position est une "une élection" du sens de
l’avenir commun au travers de cette orientation et de cette ambition. Elle lui
confère autorité pour l’engagement de la communauté. Nous
sommes là dans le contexte d’une "démocratie
élective". Il ne s’agit plus "d’élire" une
représentation par un effet de miroir (éventuellement
complaisant) mais d’assurer une position, un Sens de l’avenir dont on aura
à répondre.
L’exercice de la démocratie
élective consiste à valider l’ambition auprès de
témoins significatifs, pouvant en partager ensuite l’autorité et
la conviction pour en être les relais. Il s’agit donc de conforter la
détermination de l’autorité initiatrice par la
détermination de relais constitué d’acteurs
"significatifs" du devenir ébauché. Cette
significativité suppose un repérage qui peut se faire par
l’écho, la réponse, renvoyée par différents milieux
à la proposition faite à la communauté. L’effet de
conviction et de détermination est le gage de la validation.
La mise en mouvement
L’idée de projet est trop
souvent réduite à celle du plan ou d’un programme dont on aura
à assurer la mise en place. Or une communauté en projet c’est non
seulement des objectifs de différentes natures fixés, des
méthodes de réalisation, un cheminement et un processus de mise
en oeuvre mais c’est aussi l’implication d’un grand nombre d’acteurs là
où ils sont pour concourir au mouvement d’ensemble.
Un projet
territorial est donc une appropriation par la communauté de l’offre qui
lui a été faite. Cette appropriation sera progressive,
foisonnante, imprévisible et il s’agit pour les responsables politiques
dont la proposition a été "élue" de conduire ce
processus. Nous sommes là dans une logique de démocratie
participative qui vise progressivement le plus grand nombre, acteurs et
coauteurs du projet territorial, projection en acte de la communauté
dans le futur. La démocratie participative ne peut intervenir
qu’à ce stade comme troisième temps d’un processus
démocratique et d’une bonne gouvernance.
On n’insistera pas assez
sur l’erreur qui consiste à inverser le processus. Elle a surtout pour
effet la "mise en échec" de la démocratie,
légitimant les volontés hégémoniques et
disqualifiant les politiques. Il n’y a de participation ou de démocratie participative qu’une fois que l’identification de la communauté est assurée (représentation commune) sans laquelle c’est rapidement le conflit d’intérêt qui est seul mis en scène. Il faut aussi que l’élection du Sens et de l’ambition soit faite sinon il n’y aura pas d’entendement commun et de concourance des participations générant alors frustration et incompréhension.
La "bonne gouvernance" doit s’appuyer sur une compréhension des phénomènes humains en jeu notamment ceux de maturation collective et de dynamisation constructive du tissu social. Il y faudra des moyens approprié, animations stratégiques, conduite du changement, macropédagogies, stratégies d’évolution et de mutation, etc…
Cette gouvernance et la démocratie participative qui lui correspond n’est véritablement généralisable qu’à partir du moment où les moyens d’Internet permettent de tisser les trames et les instruments de participation et de pilotage ad-hoc.
Une urbanité virtuelle, auto génératrice d’un lien social actif est en même temps le théâtre et le moyen de ce dépassement et de l’émergence de communautés territoriales majeures. Le rôle du politique en est renforcé, la méthode en est changée et l’on voit comment les pratiques habituelles au stade d’évolution et de mutation où nous sommes considèrent trop souvent comme mineures les communautés territoriales et tutélaires les seules pratiques qui vaillent.
a gouvernance est la doctrine et la méthode d’une remise en question radicale celle d’une mutation qui commence à s’accomplir.